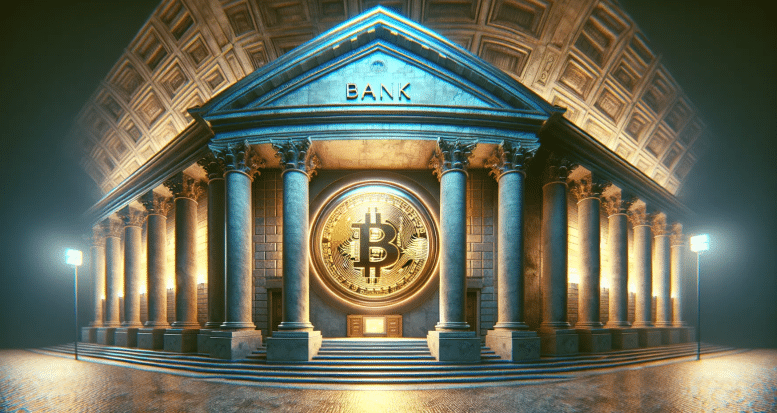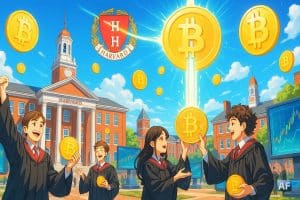La dette publique française a une longue histoire, remontant à l’Ancien Régime, qui fait que l’on pourrait presque dire… qu’elle a toujours existé. Cependant, c’est surtout à partir de la Révolution française que la dette publique moderne commence à se structurer, et l’Etat est même en faillite en 1797, lors de la « banqueroute des deux tiers » (les deux tiers de la dette publique seront annulés par les députés). Au XIXe siècle, la France a connu plusieurs périodes d’endettement élevé, notamment en raison des guerres napoléoniennes et des grands travaux d’infrastructure. Sous la IV ème République, l’État français continue à recourir à la dette afin de financer la reconstruction après-guerre et la modernisation du pays.
Mais c’est surtout depuis les années 1970, et plus encore et tout particulièrement depuis la crise sanitaire de 2019 – 2020 que la dette publique s’est envolée vers des sommets encore jamais atteints, puisqu’ elle atteignait 3 228 milliards d’euros fin 2024, ce qui lui donne un curieux aspect de « dette permanente » à laquelle non seulement les responsables politiques successifs mais aussi les citoyens semblent s’être habitués, de gré ou de force.
Qu’est-ce qui contribue à cette acceptation du principe de dette permanente ? Qu’est-ce qui fait voir par certains la dette publique comme une « recette permanente » pour l’Etat ? Pourquoi l’Etat dépense-t-il toujours davantage ?
L’évolution récente de la dette publique
Depuis les années 1970, la dette publique française a connu une augmentation continue. Cette tendance s’est accélérée avec les crises économiques successives, notamment la crise financière de 2008 et la crise sanitaire de 2020. A la fin du premier trimestre 2024, la dette publique s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros, soit 110,7 % du PIB, pour atteindre 3 228 milliards d’euros fin 2024.
L’acceptation du principe d’une « dette permanente »
C’est une spécificité franco-française, que de considérer la dette comme le mode de financement naturel de l’État, là où d’autres Etats européens, qui se sont également endettés pendant la guerre, cherchent à partir de 1945 à trouver un financement plus libéral de l’économie, par les banques ou par le marché financier. L’endettement a fondé ce que l’on a appelé « l’Etat-providence ».
L’acceptation par les Français du principe d’une dette permanente est un phénomène complexe, auquel contribuent plusieurs facteurs.
– Les crises économiques et sociales : les crises successives ont souvent nécessité des interventions massives de l’État pour soutenir l’économie et la population. Ces interventions ont été financées par l’emprunt, ce qui a contribué à une augmentation de la dette publique.
– Les politiques budgétaires : les gouvernements successifs ont souvent eu recours à l’emprunt pour financer leurs politiques, notamment en période de faible croissance économique. L’idée que l’État peut et doit intervenir pour soutenir l’économie a progressivement été acceptée par la population (« l’Etat-providence »).
– La communication politique : les gouvernants ont souvent présenté l’emprunt comme une solution nécessaire et temporaire, ce qui a contribué à son acceptation. En outre, la complexité des mécanismes financiers rend difficile pour le grand public la pleine compréhension des implications de la dette publique. Mais le recours systématique à l’emprunt conduit à une sorte de déni de cette dette.
L’emprunt, vu comme une « recette permanente »
L’idée est d’abord liée à une époque où les Français ont été massivement encouragés par des campagnes de propagande, entre 1915 et 1918 en particulier, à investir dans des « Bons du Trésor », c’est ainsi qu’à la même époque quatre vagues d’émissions de Bons ont été lancées, et avec succès. Durant cette période de conflit, la dette publique a bénéficié d’une image positive, et prêter son argent à l’État était un acte patriotique et de solidarité nationale (qui en outre rapportait de l’argent aux souscripteurs).
L’idée que l’emprunt constitue une « recette » pour l’État est également liée à la manière dont les finances publiques sont gérées. En comptabilité publique, les emprunts sont inscrits au passif du bilan de l’État, mais ils permettent de financer des dépenses immédiates. Cette approche permet de lisser les dépenses dans le temps et de financer des investissements à long terme.
C’est aussi un sentiment général qui peut être rapproché de celui vécu par certains ménages – « habitués » non par choix le plus souvent hélas, mais par obligation – à vivre « à découvert » (bancaire), qui ont négocié avec leur banque des agios annuels, et qui s’habituent à vivre avec ce découvert, comme s’il s’agissait d’un « revenu complémentaire ».
Pourquoi l’État dépense toujours plus ?
Plusieurs raisons expliquent pourquoi l’État semble incapable de restreindre ses dépenses.
– Les pressions sociales et politiques : les attentes de la population en matière de services publics (santé, éducation, sécurité sociale, sécurité) sont élevées. Les gouvernements sont souvent sous pression pour répondre à ces attentes, ce qui conduit à une augmentation des dépenses.
– Les rigidités budgétaires : une grande partie des dépenses publiques est incompressible à court terme (salaires des fonctionnaires, pensions, remboursement de la dette), ce qui limite la capacité de l’État à réduire ses dépenses rapidement.
– Les politiques de relance : en période de crise, les gouvernements ont souvent recours à des politiques de relance pour soutenir l’économie. Ces politiques impliquent des dépenses supplémentaires, financées par l’emprunt.
– L’effet boule de neige : l’augmentation de la dette entraîne une augmentation des charges d’intérêt, ce qui alourdit encore les dépenses publiques. Cela crée un cercle vicieux – et non vertueux – où la dette engendre plus de dette, et dans lequel, plus grande est la dette, plus il est difficile de revenir en arrière en la réduisant. La France n’est plus depuis longtemps dans le contexte favorable des « Trente Glorieuses », avec une forte croissance, et où le recours à l’endettement n’était pas nécessaire. En effet, en situation de plein emploi, les dépenses sociales sont bien sûr moindres, et les bonnes rentrées fiscales permettent de s’atteler au remboursement de la dette publique, ce que ne permet plus depuis longtemps notre économie, dont la croissance est en berne.
Conclusion
Les rapports des Français avec la dette de l’État sont le résultat d’une combinaison de facteurs historiques, économiques, sociaux et politiques. L’acceptation d’une dette permanente et l’idée que l’emprunt puisse constituer une « recette » pour l’État sont des phénomènes complexes, liés à la manière dont les finances publiques sont gérées et aux attentes de la population. La difficulté de restreindre les dépenses publiques est également liée à des contraintes structurelles et à des choix politiques.