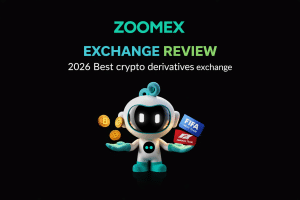La « fiducie » est un mécanisme juridique introduit en France par la loi n°2007-211 du 19 février 2007, inspiré du « trust » anglo-saxon. Elle permet à une personne, appelée le constituant, de transférer temporairement la propriété de biens ou de droits à un fiduciaire, qui les gère au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, selon les modalités définies dans un « contrat de fiducie ».
Ce dispositif offre une grande flexibilité pour la gestion patrimoniale, la sécurisation des créances ou encore la réalisation de sûretés.
Qu’est-ce exactement que la « fiducie » ? Quel est son régime fiscal, selon les catégories d’impôts qu’elle touche ? Quelles sont les particularités des contrôles fiscaux portant sur une « fiducie » ?
Définition et fonctionnement de la « fiducie »
Les parties prenantes
– Le constituant : c’est une personne physique ou morale qui transfère des biens ou des droits dans le cadre de la fiducie.
– Le fiduciaire : c’est la personne morale, généralement un établissement financier ou une société spécialisée, qui reçoit la propriété des biens ou droits transférés et les gère conformément aux stipulations du contrat de fiducie.
– Le bénéficiaire : il s’agit de la personne physique ou morale désignée pour recevoir les bénéfices issus de la gestion des biens ou droits fiduciaires.
Les modalités du « contrat de fiducie »
Elles sont définies à l’article 238 Quater B du CGI.
Le « contrat de fiducie » doit être établi par écrit et préciser notamment :
- L’identité des parties.
- La description des biens ou droits transférés.
- La durée de la fiducie.
- Les obligations et pouvoirs du fiduciaire.
- Les modalités de gestion et de restitution des biens ou droits.
Régime fiscal de la « fiducie »
La « fiducie » bénéficie d’un régime fiscal spécifique visant à assurer une neutralité fiscale lors du transfert des biens ou droits.
« Fiducie » et impôt sur le revenu
Selon l’article 238 quater N du code général des impôts (CGI), lorsque le constituant n’exerce pas une activité professionnelle, le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n’est pas un fait générateur d’impôt sur le revenu, sous réserve que :
- Le constituant soit désigné comme bénéficiaire dans le contrat de fiducie ;
- Le fiduciaire inscrive, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou valeur d’acquisition par le constituant.
Ainsi, le transfert est fiscalement neutre, évitant une imposition immédiate.
« Fiducie » et Impôt sur les sociétés
Lorsque le constituant est une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le transfert de biens ou droits dans le cadre d’une fiducie n’entraîne pas, en principe, de conséquences fiscales immédiates, sous réserve du respect des conditions prévues par le CGI. Les résultats générés par le patrimoine fiduciaire sont imposés selon les règles applicables aux sociétés de personnes, le fiduciaire étant tenu aux obligations déclaratives correspondantes.
« Fiducie » et Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Les biens immobiliers transférés dans le cadre d’une « fiducie » restent en principe inclus dans l’assiette de l’IFI du constituant, sauf si le bénéficiaire est une personne distincte et que le constituant n’a plus la jouissance des biens. La situation doit être analysée au cas par cas pour déterminer l’imposition à l’IFI (cf : article 635, 1-8 du CGI ; 668 bis et ter et s. du CGI).
« Fiducie » et taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La fiducie peut être assujettie à la TVA si elle réalise des opérations entrant dans le champ d’application de cette taxe. Le fiduciaire, en tant que détenteur des biens ou droits, est responsable des obligations déclaratives et du paiement de la TVA afférente aux opérations effectuées dans le cadre de la « fiducie ».
« Fiducie » et impositions directes locales
Les biens immobiliers détenus en fiducie sont soumis aux impositions directes locales, telles que la taxe foncière. Le fiduciaire, en sa qualité de propriétaire légal des biens, est redevable de ces taxes et doit s’acquitter des obligations correspondantes.
A la fin du « contrat de fiducie », le fiduciaire et le constituant sont tenus de tirer à l’égard du patrimoine fiduciaire, les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise telle que prévue à l’article 201 du CGI, c’est-à-dire que la fin du « contrat de fiducie » se traduit par l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés, des plus-values constatées à l’occasion de la cessation de la « fiducie », et les provisions non encore réintégrées.
Contrôles fiscaux applicables aux « fiducies » et fiduciaires
Les « fiducies » et les fiduciaires sont soumis aux procédures de contrôle fiscal prévues par le Livre des procédures fiscales (LPF).
Vérification de comptabilité
Conformément à l’article L.13 du LPF, les « fiducies », représentées par leur fiduciaire, peuvent faire l’objet d’une vérification de comptabilité. Cette procédure permet à l’administration fiscale d’examiner sur place la régularité et la sincérité des écritures comptables de la fiducie. Le fiduciaire doit présenter tous les documents comptables relatifs à la gestion du patrimoine fiduciaire.
Examen de comptabilité
L’examen de comptabilité est une procédure de contrôle fiscal à distance, réalisée à partir des fichiers des écritures comptables (FEC) transmis par l’entreprise. Bien que cette procédure concerne principalement les entreprises, les fiduciaires peuvent également être soumis à un tel examen pour les « fiducies » qu’ils gèrent, notamment si la comptabilité est tenue de manière informatisée.
Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP)
L’ESFP vise à contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par une personne physique et sa situation patrimoniale. Si le constituant ou le bénéficiaire d’une « fiducie » est une personne physique, l’administration fiscale peut procéder à un ESFP pour s’assurer que les revenus issus de la « fiducie » sont correctement déclarés et que la situation fiscale personnelle est cohérente avec les éléments patrimoniaux détenus.
Conclusion
La « fiducie » est un outil de gestion patrimoniale puissant mais complexe. Son cadre juridique et fiscal impose une maîtrise précise de ses implications. Les contrôles fiscaux renforcés garantissent la transparence de ce mécanisme, réduisant ainsi les risques d’abus.