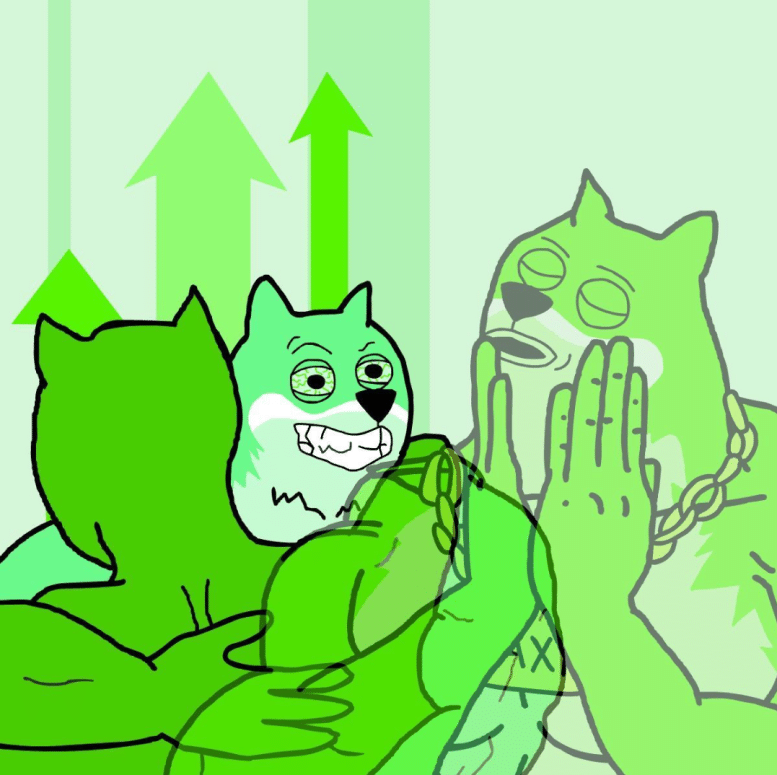En France, la déclaration de succession constitue une obligation légale incontournable pour les héritiers d’un défunt. Conformément à l’article 641 du code général des impôts (CGI), cette déclaration doit être effectuée dans un délai de six mois à compter du décès survenu en métropole.
Or, cette exigence se heurte de manière récurrente à la complexité émotionnelle, administrative et patrimoniale qui accompagne le deuil. Face à un taux de non-respect du délai qui dépasse les deux tiers des cas, l’administration fiscale a, depuis 2024, radicalement modifié son approche.
Fini le temps de la tolérance : la Direction générale des finances publiques (DGFIP) impose désormais des pénalités automatiques, appuyées par une surveillance technologique accrue, pour recouvrer les droits de succession dans les temps.
Ce tournant s’explique par des impératifs budgétaires, des innovations numériques et une volonté de lutte contre l’évasion fiscale, impliquant une sévérité nouvelle, des procédures de relance désormais mises en œuvre par l’administration, ainsi que des sanctions encourues en cas de non-respect du délai légal.
Une administration fiscale sous pression : les ressorts d’un durcissement inédit
Une urgence budgétaire, et un rendement fiscal menacé
Le premier moteur de cette rigueur renforcée réside dans les impératifs budgétaires de l’Etat. En effet, les droits de succession représentent une recette importante pour le Trésor public. Or, la Cour des comptes a révélé en 2024 que seulement 30 % des déclarations de succession ont été déposées dans les délais légaux, compromettant le recouvrement optimal des droits dus.
L’administration ne dispose par ailleurs que de six ans à compter du décès pour recouvrer ces droits (délai de reprise de droit commun, hormis délais spéciaux), ce qui la contraint à intervenir vite et efficacement.
La fin d’une approche bienveillante, sous l’effet d’instructions fermes
Autrefois marquée par une certaine indulgence – les héritiers invoquant la peine du deuil, des délais notariaux ou des complexités patrimoniales (difficultés ou mésententes familiales par exemple) pour justifier leur retard –, l’administration fiscale a changé de posture.
Depuis 2024, les demandes de remise gracieuse fondées sur l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales (LPF) sont quasiment toutes rejetées. Cette mutation, confirmée par les notaires et fiscalistes, repose sur une volonté explicite de rationaliser la gestion des dossiers et d’optimiser la rentabilité du contrôle fiscal.
L’outil numérique comme catalyseur de la rigueur
Le durcissement est également rendu possible par une révolution technologique au sein de la DGFIP. Dès fin 2023, l’administration fiscale s’est dotée de l’application « Suivi succession », enrichie par l’assistant digital AD-RS, un robot connecté à plusieurs bases de données : Adonis (dossier fiscal des particuliers), BNDP (données patrimoniales), FICOVIE (assurances-vie) et FICOBA (comptes bancaires).
Ces outils permettent d’identifier automatiquement les décès et d’évaluer la consistance d’un patrimoine, détectant ainsi les successions à enjeu (c’est-à-dire potentiellement génératrices de droits à recouvrer). Ce repérage intelligent conditionne l’activation d’une procédure de relance automatisée.
Une mécanique de relance progressive, impitoyable et automatisée
Un premier rappel à l’ordre dès le 7e mois : les intérêts de retard
Dès que l’application « Suivi succession » repère un dossier non régularisé à partir du 6e mois suivant le décès, une première lettre de relance est envoyée par le service départemental de l’enregistrement.
A ce stade, même sans mise en demeure formelle, des intérêts de retard de 0,20 % par mois (article 1727 CGI) s’appliquent, calculés sur le montant estimé des droits dus. Les héritiers doivent également remplir un formulaire recensant les éléments du patrimoine du défunt, les libéralités antérieures, et produire tous actes pertinents.
Une mise en demeure formelle au 13e mois : des majorations s’appliquent
Si aucune déclaration n’est déposée, une mise en demeure est adressée aux héritiers, en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du LPF. Ils disposent alors de 90 jours pour s’exécuter. Passé ce délai :
- Une majoration de 10 % s’applique dès le 13e mois.
- En l’absence de réaction dans les 90 jours suivants la mise en demeure, une majoration de 40 % est appliquée (article 1728 CGI).
- En cas de « manquement délibéré » prouvé, la majoration peut atteindre 80 % (article 1729 CGI).
Cette sévérité automatique ne laisse que peu de marges de manœuvre, sauf à démontrer une situation exceptionnelle justifiant un traitement spécifique.
Une stratégie ciblée sur les successions à enjeux fiscaux
L’administration ne relance pas systématiquement tous les dossiers : elle opère une sélection basée sur le niveau d’enjeux fiscaux. Par exemple, un héritage de 100 000 euros transmis à un neveu (taxé à 55 %) est considéré comme prioritaire, tandis qu’un patrimoine équivalent transmis à un enfant (abattement de 100 000 euros) peut être ignoré. Cette stratégie s’appuie sur une analyse fine des profils fiscaux et des bénéficiaires potentiels.
Sanctions et voies de recours : l’héritier face à la machine fiscale
Des pénalités automatiques, sans considération pour la bonne foi
Les héritiers ne sont plus épargnés, même s’ils ont agi de bonne foi ou rencontré des obstacles concrets. Les majorations prévues par les articles 1728 et 1729 du CGI s’appliquent mécaniquement, sans qu’un agent du fisc ne prenne en compte les circonstances. Les demandes de reports exceptionnels de délais de dépôt des déclarations de succession, tout comme celles de remise gracieuse, autrefois envisageables, sont devenues très rares, voire illusoires.
La tentation du recours contentieux : une arme à double tranchant
En l’absence de succès dans la voie amiable, les héritiers peuvent engager un recours judiciaire auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal administratif selon le cas, afin de demander une modulation ou une annulation des pénalités. Toutefois, cette procédure est longue, coûteuse et incertaine.
Le juge peut exercer un contrôle de proportionnalité et annuler des pénalités manifestement excessives, mais il n’est pas tenu d’accorder systématiquement une réduction.
Vers une dématérialisation totale et une surveillance continue
Entre 2025 et 2027, l’administration prévoit de dématérialiser totalement la déclaration de succession, en instaurant une télédéclaration obligatoire. Couplée à l’intelligence artificielle (IA), cette évolution vise à supprimer les failles du système actuel. À terme, la machine fiscale pourrait anticiper les comportements, alerter les héritiers dès le décès, et intégrer automatiquement certaines données dans les formulaires.
Conclusion
Depuis 2024, la politique fiscale en matière de successions a franchi un cap décisif. Ce changement de paradigme repose sur une double logique : d’une part, l’exigence de rentabilité budgétaire dans un contexte de finances publiques sous tension ; d’autre part, l’émergence de nouveaux outils numériques qui rendent possible une surveillance quasi-instantanée des décès et des transmissions patrimoniales.
La procédure de relance, désormais automatisée et implacable, ne laisse guère de place aux aléas de la vie ni aux lenteurs administratives. Les pénalités tombent mécaniquement, comme un couperet, sans tenir compte du vécu des familles endeuillées.
Ce glissement vers une fiscalité technocratique interroge toutefois : une réforme du délai de six mois, aujourd’hui inadapté à la complexité des successions modernes, ne serait-elle pas plus équitable que le durcissement unilatéral d’un système où 70 % des contribuables sont en infraction dès le départ ? Le débat reste ouvert, mais la bienveillance fiscale semble, elle, bel et bien enterrée.